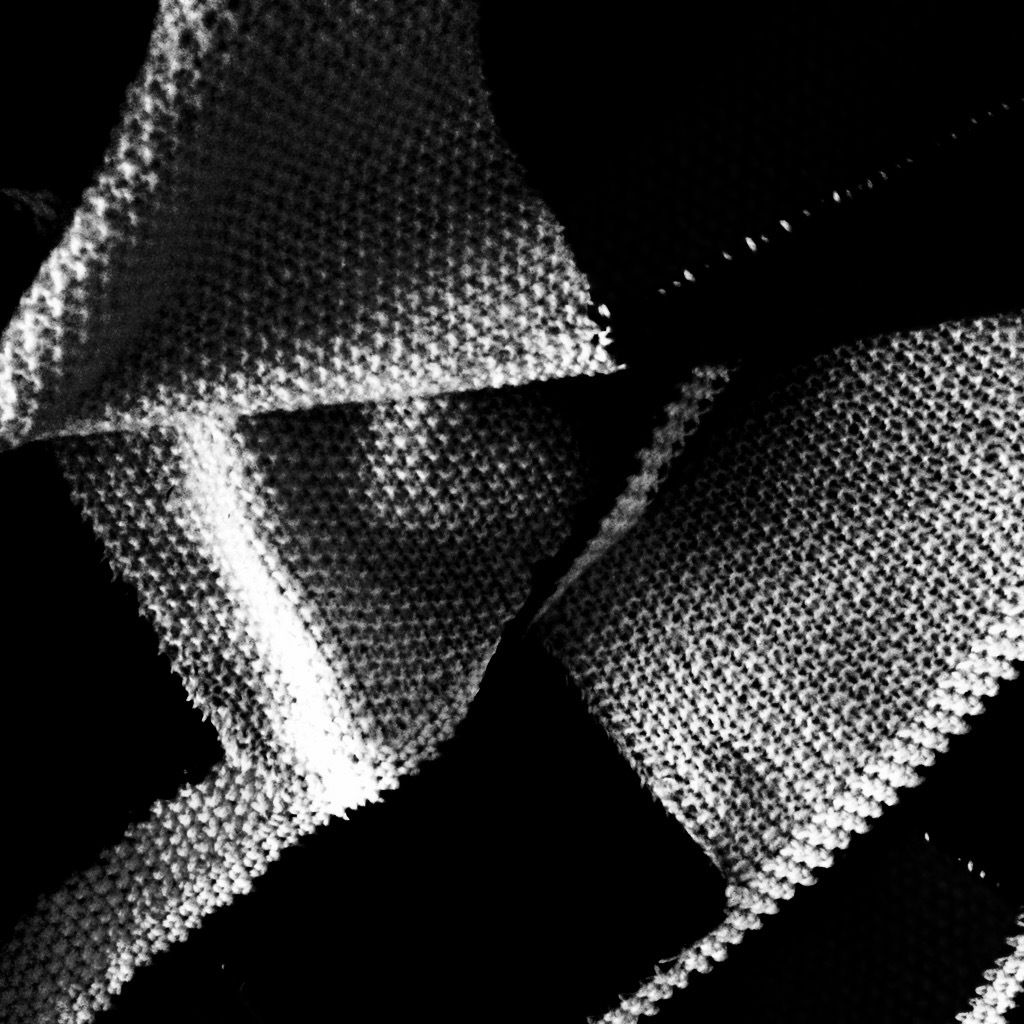Demain, et après …
Pourquoi ne pas applaudir de plus près ?
A demain ! Sur deux pieds !
Avec notre morceau de piano bien accordé,
Notre duo à quatre mains
Fera l’ouverture demain,
Et après- demain,
Quand tu auras pris ma main.
Ça reste du par cœur pour nos dix doigts,
Sans impro,
Et de nos deux mains,
Lier un seul nom, pour deux cœurs.
Après-demain,
Ta main et ma main,
Pour deux paires de mains
Et dix doigts fois deux.
Ça fait huit doigts ?
Non.
Ça fait vingt doigts,
Qui joueront à vingt heures,
Samedi en huit.
C’est une sacrée paire de manches
Pour relever le défi,
Un beau morceau de main de maître.
Plus que deux mètres,
Mais demain,
La scène fera plusieurs dizaines de mètres,
Elle peut se compter en pieds,
Mais pas en mains.
Elle se mesure à l’aide d’un chef d’orchestre,
Un joailler d’harmonie mesurée,
Taillant avec deux mains et une baguette,
En un temps sans désaccord,
Une musique de grand maître qui prend son temps.
Hier, ou bien avant encore,
Il y avait déjà un demain,
Et un après-demain,
Qui se composent à quatre mains,
Ou bien plus,
Qui se précèdent,
Puis se laissent parcourir avec deux pieds,
Et une croche,
Qui double dès qu’on l’approche.
Si demain double sa croche,
Le morceau continue sa musique, son tempo,
Demain passe à après-demain,
Pour se souvenir l’instant où
Tu as décidé de prendre ma main,
Pour vivre à deux nos lendemains.
Sculpture : Auguste Rodin
©ND
Texte : Céline Justand
(2015)
-Justand Mots-
/image%2F2369803%2F20171014%2Fob_6f30eb_87fe79d3-533b-4702-aa0c-7561fb173079-6.png)